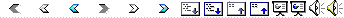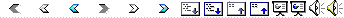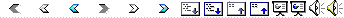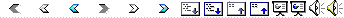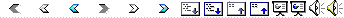|
1
|
- On a tendance à confondre le genre (catégorie morphosyntaxique) avec le
sexe (réalité du monde d’ordre sémantique).
- les marques casuelles (dominus, domina, templum) ont disparu du français
contemporain, et le genre (ainsi que le nombre) est porté principalement
par les déterminants (60% du lexique ne change pas de forme sonore selon
le genre).
- Pour les êtres animés l'opposition de genre est généralement pertinente
sémantiquement :
- un locataire / une locataire
- mais pas pour les non animés
- une pomme, un citron
- Si on dit :
- On viole une contrainte formelle, mais le genre reste inerte
sémantiquement. Le locuteur sera exposé à un jugement
sociolinguistique, mais il n'en resuletera pas de doute sur le sexe de
la pomme.
- l'opposition de genre est généralement non pertinente pour les animés
non humains :
- une girafe, une mésange, une panthère, une antilope
- Ces animaux portent un genre formel comme s’il s’agissait d’êtres
inanimés.
- De plus, lorsque le genre peut être marqué sémantiquement, le masculin
renvoie parfois à l’espèce :
- Mon voisin a un très beau chat sur les genoux. C'est la chatte de
Lucie.
|
|
2
|
- Il est plus simple de se baser sur la langue parlée pour acquérir les
formes orales en FSL et non sur les marques de la langue écrite, au
risque de
- ranger dans la même catégorie des formes aussi diverses du point de vue
de l’oral que :
- clair/clair, fin/fine, plat/plate, net/nette, sot/sotte,
ancien/ancienne
- distinguer pour des raisons orthographiques des formes comme :
- jaloux/jalouse et gris/grise qui forment leur féminin en [z]
- épais/épaisse et doux/douce qui forment leur féminin en [s]
- Le masculin étant considéré comme non marqué, il vaut mieux partir des
formes féminines.
(ex. commencer par intérioriser les noms féminins en -euse, -eure,
-eresse et -trice pour retrouver la forme en -eur au masculin.)
- Il faut distinguer les substantifs ayant un genre par nature et l’accord
du genre qui affecte les adjectifs, les déterminants et certains pronoms
personnels (il/elle), relatifs et
interrogatifs (laquelle)
|
|
3
|
- Ajout d’un «e» caduc
- Alternance de consonnes finales
- Alternance lexicale
- Alternance suffixale
|
|
4
|
- Selon le Petit Robert 30% du lexique français peut s’employer aussi bien
au féminin qu’au masculin.
- À l’oral 60% (8 800 unités lexicales) ont une forme sonore invariable
- ami / amie, noir / noire
- (d’où l’importance d’apprendre les substantifs avec leur déterminant au
singulier qui peut se neutraliser au pluriel)
- À noter également que certains
déterminants et modificateurs du substantif qui se distinguent à l’écrit
se neutralisent à l’oral devant une voyelle.
- cet/cette, bon/bon, bel/belle, gentil/gentille
|
|
5
|
- 40 % du lexique français (5 800 unités) se caractérise par une
alternance de formes entre le masculin et le féminin. Le genre est
marqué à l’oral selon trois procédés possibles :
- par ajout
- par alternance
- par effacement
- Les marqueurs peuvent être de quatre ordres :
- vocalique
- consonnantique
- suffixal
- lexical
|
|
6
|
- Ajout d‘une consonne prononcée (morphème Ø / C)
- Sans modification vocalique
- blanc / blanche [blÅ / blÅS]
- marquis / marquise [mårki / mårkiz]
- Avec modification vocalique
- meunier / meunière [mø˜e / mø˜‰r]
- voisin / voisine [vwaz´ / vwazin]
- Ajout d’un suffixe (morphème Ø / S)
- sans changement vocalique ou consonnantique
- traître / traîtresse [tr‰tr / tr‰tr‰s]
- avec variation
- vocalique : poète / poétesse [po‰t / poet‰s]
- consonnantique : duc / duchesse [dyk / dyS‰s]
|
|
7
|
- Alternance consonnantique (C / C)
- actif / active [aktif / aktiv] (voisement)
- fils / fille [fis / fij]
- chanteur / chanteuse [SÅtOr / SÅtøz] ( + alternance vocalique)
- Alternance vocalique (V/ V)
- le / la [lE / la]
- mon / ma [mõ /ma ]
- il / elle [il / ‰l]
- Alternance lexicale (L /L)
- bélier / brebis
- coq / poule
- oie / jars
- frère / sœur
- monsieur / madame
|
|
8
|
- Suppression vocalique
- compagnon / compagne [kõpa˜õ / kõpa˜]
- dindon / dinde [d´dõ / d´d]
- mulet / mule [myl‰ /myl]
- Suppression suffixale
- canard / cane [kanar/kan]
- vieillard / vieille [vj‰jar/ vj‰j]
|
|
9
|
- VARIATION HISTORIQUE
- D'après Le bon usage de Grevisse, jadis, on disait :
- VARIATION SOCIOLINGUISTIQUE
- Ces variations proviennent de ce qu’en français familier québécois, les
apocopes sont la plupart du temps au masculin et les emprunts souvent
féminisés, surtout lorqu’ils se terminent par une consonne prononcée).
certains termes commençant par une voyelle sont parfois féminisés à
l’oral (une autobus), sans oublier la féminisation des titres (une
ministre, une écrivaine), plus fréquente au Canada qu’en France.
- VARIATION DE SENS PAR LE GENRE
|
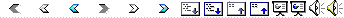
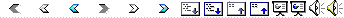
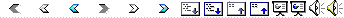
 Notes
Notes